« Internet Justice Warriors ? »
En 2010, suivant la publication d’une vidéo traumatisante de la tuerie de chatons, une communauté d’utilisateurs Facebook a commencé la recherche du coupable. Dans la série documentaire Netflix Don’t F**k With Cats, on suit l’histoire morbide d’un groupe d’individus qui a identifié Luka Rocco Magnotta comme étant le responsable et qui a tenté de le faire arrêter avant qu’il ne puisse aller plus loin. Je vous épargne les détails. Une écoute fascinante, où on en apprend énormément sur les communautés internet, sur les groupes Facebook et sur la force de justice publique que les réseaux sociaux nous apportent au 21e siècle. TraceLabs en est un autre exemple. Un organisme à but non lucratif, TraceLabs a comme mission d’aider à localiser des personnes portées disparues en utilisant de l’information publique retrouvée sur internet ou « open source » (OSINT). Le pouvoir que nous avons au bout de nos doigts afin de contrer les injustices dans notre société devient aujourd’hui infini. Il est donc facile de comprendre pourquoi avec la deuxième vague de dénonciation #MeToo ou #MoiAussi que les plateformes des réseaux sociaux ont été utilisées afin de contrer ces injustices. Demeure que ces plateformes sont des armes à doubles tranchants.
Étant une victime #MoiAussi, cela m’est difficile d’en parler et encore plus de pointer du doigt les individus impliqués. On lit les décisions, on voit les réactions du public, les commentaires… On voit comment les faits sont tordus et comment une victime se retrouve souvent isolée, moquée ou considérée fautive. Ces dossiers sont réduits à des discussions de table sur la véracité d’une accusation. Le dossier Jian Ghomeshi en est un exemple qui me vient en tête, ou encore lorsque Christine Blasey Ford a dénoncé le comportement du juge de la Cour Suprême des États-Unis Brett Michael Kavanaugh. C’est décourageant pour en dire le moins.
Système d’injustice
On s’aperçoit que notre système de justice n’est pas assez adéquat afin de porter justice aux victimes d’agression sexuelle. Actuellement, il y a des discussions concernant des réformes possibles afin de mieux encadrer ces dossiers. Notamment, le projet de loi 55 a été apporté par l’ancienne Ministre de la Justice Sonia Lebel en juin 2020. Ce projet vise à modifier le Code civil du Québec afin de rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale et est entré en vigueur le 12 juin 2020. C’est une bonne initiative au niveau de notre pouvoir provincial de légiférer, mais ne concerne aucunement notre système de justice pénale.
Le Ministre de la Justice et Procureur Général du Canada, David Lametti, a justement déposé le projet de loi C-5 qui vise à améliorer cette situation. Ce projet veut rendre obligatoire une formation destinée aux juges afin de mieux leur faire comprendre les cas d’agression sexuelle.
C’est mieux que rien…
Dénonciation sur internet
Par contre, les changements nécessaires ne sont pas en place et plusieurs ont pris la décision de dénoncer leurs agresseur(e)s sur les réseaux sociaux et je les comprends! C’est une manière de se faire justice certes, mais plus encore d’identifier les individus « dangereux ». Pages Facebook, Instagram, blogues et autres. C’est facile, c’est vite et c’est anonyme. Je ne veux aucunement réduire les voix de ces individus courageux ni réduire la violence qui leur a été induite. C’est terrible et si je pouvais trouver une manière de réduire leur douleur et d’empêcher cette sorte de comportement à tout jamais, je le ferais. Le problème c’est qu’il n’y en a pas et que le recours vers les médias sociaux n’est peut-être pas la meilleure option. D’un point de vue logistique, ces publications sont nombreuses, perdues parmi des centaines, faciles à se confondre avec d’autres et tout aussi retrouvées sur Google avec un mot clé. D’un point de vue juridique, cette dénonciation ne va pas en soit apporter des accusations criminelles en cours ni faire reconnaître la culpabilité de l’individu. Du point de vue humain, il arrive qu’il y ait de fausses allégations et accusations, tel que le cas de Mohamed Mehdi Ghanmi.
C’est lors de ces fausses dénonciations qu’il est important de se souvenir qu’il y a un grand principe qui soutient notre système de justice pénale: la présomption d’innocence. En discutant de la Commission Charbonneau, maître Frédéric Bérard a écrit ceci concernant ce droit fondamental :
« La présomption d’innocence et le droit d’être entendu sont, aux yeux de certains, des concepts visant à protéger les bandits. Tirons d’abord et, ensuite, nous poserons les questions. […] Ces concepts possèdent pourtant une vertu fondamentale : celle d’éviter de sacrifier inutilement des réputations, des vies professionnelles ou privées, et de canaliser la soif de vengeance populaire et médiatique. »[1]
Même si cette citation a été publiée en 2014 avant le mouvement #MeToo/#MoiAussi, je la trouve malheureusement très pertinente… Les réseaux sociaux sont devenus non seulement un tribunal populaire où la présomption d’innocence demeure invisible, mais sont devenus un outil de vengeance.
Nous voici en septembre 2020.
Dossier : Dis son nom
Lors du mois de juillet, une page Facebook intitulée Dis son nom a été créée et a dressé une liste « d’agresseurs présumés » sur la base de témoignages. La liberté d’expression accorde le droit aux victimes de dénoncer leurs agresseurs. Cette liberté est un droit fondamental qui est protégé en vertu de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] (ci-après Charte québécoise) ainsi que par l’article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés[3]. Ces dénonciations ont pourtant un impact sur la réputation de ceux ou celles qu’elles concernent, incluant Jean-François Marquis. Le droit au respect de sa réputation est un droit reconnu par l’article 4 de la Charte québécoise. L’article 35 du Code civil du Québec [4](ci-après CCQ) protège aussi contre les atteintes à la réputation permettant ainsi un recours en diffamation. Il devient facile d’apercevoir la confrontation entre ces deux droits fondamentaux, et tel qu’indique la Cour Suprême dans la décision Bou Malhab c. Métromédia CMR inc., il faut trouver une manière de concilier la protection du droit à la réputation à la protection de la liberté d’expression.
Monsieur Jean-François Marquis a déposé le jeudi 10 septembre 2020 une poursuite contre la page Dis son nom et demande que le ou les administrateurs de la page sorte(nt) de l’anonymat. Selon lui, des noms, incluant le sien, auraient été publiés dans leurs listes sans mécanisme de vérification connu. Il aurait perdu des contrats, et des amis proches auraient cessé de lui adresser la parole suivant l’ajout de son nom. Tel que clarifié dans l’entrevue de Pierre Trudel avec Isabelle Richer, le dossier concerne une question de diffamation.
Diffamation
Alors, qu’est-ce qu’une action en diffamation?
La Cour suprême a repris la définition de la diffamation élaborée dans la décision Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc. :
« Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. (…) Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. »
On parle donc d’atteinte injuste à la réputation, des propos ayant pour effet d’humilier ou de lui faire perdre l’estime des autres, qui peut être fausse ou non, mais qui doit absolument résulter d’un geste fautif de leur part.
Cette action repose sur les principes de la responsabilité civile et de l’article 1457 CCQ. Il faut être en mesure d’établir dans ce dossier une faute, un dommage et un lien de causalité. Je crois qu’on peut tous être d’accord sur le fait qu’être publiquement accusé d’agression sexuelle peut être endommageant et que M. Marquis prétend avoir subi des préjudices associés à cette publication d’allégations supposément non fondées. Tout ceci va devoir être démontré en preuve. Reste à savoir quelle est la faute commise par la page Dis son nom? Le demandeur va réclamer que les administrateurs n’ont pas usé de prudence en publiant les noms des accusés sans prendre le temps de vérifier les faits allégués. La question va se débattre là… Une faute en matière de diffamation suppose « l’appréciation du comportement de la personne, compte tenu de son domaine d’activité »[5]. Ce n’est pas équivalent à une responsabilité professionnelle et va s’apprécier en fonction du contexte :
« Dans le cadre de l’analyse de l’activité de l’agent au moment où le préjudice a été causé et les conditions dans lesquelles elle s’exerçait, les tribunaux tiennent compte notamment a) des activités de la personne au moment de la diffusion des propos diffamatoires, b) du type d’informations émises et c) du contexte de la diffusion des propos. »[6]
Dans le contexte d’une page Facebook, est-ce qu’on peut vraiment demander que les administrateurs vérifient chaque témoignage? Est-ce que la communication de l’information fut responsable? Comment est-ce qu’ils peuvent faire cette vérification? Par contre, est-ce qu’on peut laisser ces accusations passer sans faire attention à ceux qui peuvent être nuis sans cause juste? Doit-on plus tenir compte du fait que les administrateurs ne sont pas nécessairement des journalistes et simplement des individus qui se comportent en bons samaritains ou de l’ampleur de l’impact de se faire accuser d’agresseur? Si elles sont ou ont déjà été journalistes, comme l’administratrice Delphine Bergeron, est-ce qu’on va tenir compte de cela?
N’oubliez pas que ceci concerne des allégations que le demandeur prétend être fausses et mal fondées. En apportant ce dossier à la cour, celui-ci va être une audience publique où les parties vont devoir apporter une preuve, être contre-interrogées. Prenez note que M. Marquis ne poursuit pas celle qui l’a dénoncé mais bien la page Facebook et les administrateurs. Il va chercher à démontrer leur faute et que leur « mauvaise gestion » lui a provoqué préjudice.
Irresponsabilité des réseaux sociaux
Finalement, on peut aussi se questionner si le recours devrait plutôt se faire contre Facebook. Est-ce réalisable que Facebook vérifie toute l’information diffusée sur leur plateforme? Aux États-Unis, l’article 230 du Communications Decency Act (ci-après CDA) traite de ce sujet. L’article 230c)(1) CDA accorde une immunité aux sites internet face aux commentaires de leurs utilisateurs qui peuvent être illégaux ou diffamatoires. L’article 230c)(2) CDA accorde une autre immunité aux sites internet en leur permettant d’avoir un système d’autorégulation, de modération ou d’édition du contenu. Twitter, Facebook et Instagram n’ont aucune responsabilité face aux contenus qui se trouvent sur leurs sites aux États-Unis. Ils ne sont aucunement responsables. Ces corporations énormes n’ont aucune responsabilité face à leurs utilisateurs ni en ce qui concerne l’information sur leur page, ni en ce qui concerne le contenu qu’ils diffusent. Prenez un instant pour absorber cette information. Il y a des discussions concernant une réforme de cette loi adoptée en 1996.
Quand est-il au Québec?
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après LCCJTI) fut adoptée en 2001 et organise le statut des documents juridiques en fonction de la nouvelle réalité technologique. La loi a comme mission d’uniformiser la valeur des documents, d’assurer une sécurité juridiques des communications, de trouver une équivalence fonctionnelle des documents et ce, peu importe leur support. Tel l’explique le professeur Pierre Trudel :
« cette loi prévoit, entre autres, des règles balisant la responsabilité des prestataires de services agissant, à divers titres, en tant qu’intermédiaire dans la recherche, l’hébergement, l’archivage ou la transmission de documents ».
Les articles 22, 26, 36 et 37 touchent aux questions de responsabilité. On y remarque que le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire est aucunement responsable, sauf lors des quelques circonstances inscrites dans la loi.
L’article qui nous concerne ici est l’article 22 LCCJTI. Il stipule que le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication, n’est pas responsables des activités accomplies par l’utilisateur du service, sauf exception : s’il a pris connaissance des documents conservés servant à la réalisation d’une activité à caractère illicite, ou s’il a connaissance de circonstances qui la rende apparente et qu’il n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. La responsabilité de ces acteurs est donc, jusqu’à preuve du contraire, inexistante…
L’article 27 LCCJTI ajoute que le prestataire de services n’est pas tenu d’en surveiller l’information, ni de rechercher les circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d’activités à caractère illicite. En analogie, le propriétaire d’un immeuble ou d’un hôtel ne serait pas responsable du comportement des habitants ou des locataires qui s’y trouvent.
Par contre, ce manque de responsabilité a une limite : celle du comportement à caractère illicite. Contrairement à un comportement illégal (donc contraire à la loi), une activité illicite peut constituer une faute au sens de la loi.
Faute
On se retrouve ici encore en train de se questionner sur l’existence d’une faute. Il faudrait d’abord déterminer si la page Dis son nom a bien commis cette faute et ensuite déterminer si Facebook a eu connaissance de ce qu’on pourrait maintenant qualifier d’activité à caractère illicite. Cependant, les articles 26 et 27 LCCJTI établissent qu’il n’y a pas d’obligation de surveillance active. Bref, pour qualifier Facebook de responsable, il faudrait d’abord établir qu’il y a eu faute, donc qu’il y aurait eu un comportement illicite, et ensuite en informer l’intermédiaire qui devrait agir. C’est seulement en cas d’inaction qu’on pourrait engager sa responsabilité. Par contre, l’article 22 al. 2 LCCJTI ne nous donne pas une liste exhaustive des cas où la responsabilité peut être engagée et il se pourrait que la Cour agrandisse l’application de cet article.
Demeure que présentement il n’y a aucune décision qui nous permet de mieux comprendre l’application de l’article 22 LCCJTI ou de savoir si oui ou non un prestataire de services serait responsable.
Une conclusion?
Ce n’est qu’un début. La suite de cette poursuite déposée par Jean-François Marquis risque d’annoncer des changements importants au sein de la responsabilisation des individus face à leur utilisation des réseaux sociaux ainsi que de la responsabilisation des réseaux sociaux eux-mêmes! Ici, une importante question d’intérêt public demeure. Il faut permettre aux victimes d’agression sexuelle d’avoir une voix, de se faire entendre et leur donner la justice à laquelle ils ont droit. Ces comportements criminels attaquent l’intégrité d’une personne, les marquent, leur laissent des séquelles et des cicatrices qu’on ne peut pas nécessairement voir à l’œil nu. Par contre, il ne faut pas nier qu’il a aussi une personne derrière le nom qui a été dénoncée comme agresseur sur internet. Ces personnes ont des familles, des carrières, des ambitions. D’autant qu’il est important d’apporter une justice aux victimes d’agressions, il faut trouver une manière de protéger ceux qui sont faussement allégués d’abus sexuels, parce qu’en fin de compte, ce sont eux qui deviennent aussi des victimes : victimes du tribunal populaire.
Il y a un grand manque au sein de
notre système de justice actuel et il faut l’aborder.
[1] Frédéric BÉRARD, La fin de l’état de droit?, Montréal, Les Éditions XYZ inc., 2014, p.73.
[2] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3.
[3] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)], art. 2b).
[4] Code Civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 35 et ss.
[5] TRUDEL, P., note de cours DRT-3805, Droit de l’information et de la communication; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc. 1994 CanLII 5883 (QC CA).
[6] Patrick A. MOLINARI et Pierre TRUDEL, «Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée: Aspects généraux et applications», dans BARREAU DU QUÉBEC, FORMATION PERMANENTE, Application des chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1988, 197, 204-207.
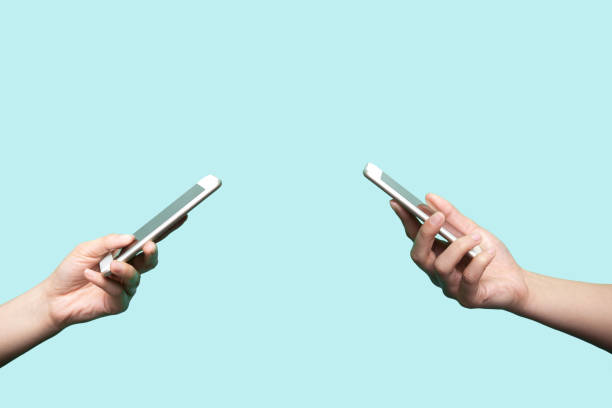
Commentaires